Cet article est une petite étude sur les maires qui se sont succédés dans la commune de Neuvic depuis 1792.
Pour le 19e siècle, les archives conservées ne sont pas nombreuses et en particulier les registres de délibérations ne sont disponibles qu’à partir de 1831. Cependant, les registres d’état civil permettent de connaître les signataires des actes et de reconstituer la généalogie des premiers maires.
NB : un article de JJ Elias, paru dans le bulletin municipal, contenait des informations reprises et développées ici.
| Début de mandat | Fin de mandat | Nom du maire | Adjoint |
| 1792 | Louis Deffarges | ||
| Charles Cahagne-Latour | |||
| Pierre Cluseau-Lanauve | |||
| Jean Cabirol | |||
| 1813 | Arnaud Reymondie | Louis Deffarges | |
| 1813 | 1815 | Charles de Mellet | Pierre Bornet-Léger |
| 1815 | 1827 | Pierre Bornet-Léger | Jean Faure |
| 1828 | 1829 | Arnaud Reymondie | Bornet-Lagirondie |
| 1829 | 1836 | François Chapelou St Pey | Bornet-Lagirondie, puis Devillesuzanne-Lagarde |
| 1836 | 1848 | François Devillesuzanne-Lagarde | Lachaize |
| 1848 | 1850 | Léon Cluseau-Lanauve | Antoine Maze |
| 1851 | 1852 | Antoine Maze | Décoly |
| 1852 | 1854 | François Bornet-Léger | Antoine Maze |
| 1854 | 1870 | François Devillesuzanne-Lagarde | Antoine Maze |
| 1870 | 1870 | Alban Cluseau-Lanauve | Antoine Maze |
| 1870 | 1873 | Claude Vidal | Armand Rougié |
| 1873 | 1878 | Gabriel Grellety-Bosviel | Armand Rougié |
| 1878 | 1879 | Eymard Lapeyre | Alban Cluseau-Lanauve |
| 1879 | 1882 | Gabriel Vidal | Alban Cluseau-Lanauve |
| 1882 | 1888 | Gabriel Bosviel | Armand Rougié |
| 1888 | 1892 | Armand Rougié | Jean Bordier |
| 1892 | 1893 | Gabriel Mathet | Alexis Maze |
| 1893 | 1895 | Félix Justin Gaussen | Paul Texier |
| 1895 | 1896 | Armand Rougié | Bosredon |
| 1896 | 1905 | Félix Justin Gaussen | Pierre Lescure, puis Paul Texier (1897) |
| 1905 | 1918 | Eugène Gallais | Paul Texier |
| 1918 | 1925 | Louis Dubos | Jean Edmond Lavignac |
| 1925 | 1929 | Fernand Laporte | Jean Lavignac |
| 1929 | 1931 | Yvan de Laporte | Camille Valentin |
| 1931 | 1941 | Camille Valentin | Georges Gaussen |
| 1941 | 1943 | Fernand Rousset | Servant |
| 1943 | 1944 | Fernand Laporte | Rousset |
| 1944 | 1945 | Camille Valentin | Georges Gaussen |
| 1945 | 1953 | Georges Gaussen | Léo Marigeaud, puis Paul Deffarges(1947) |
| 1953 | 1976 | Jean-Robert Pascaud | Jean Durieux et Albert Chevalier |
| 1976 | 1977 | Albert Petit | |
| 1977 | 1983 | Albert Labrue | |
| 1983 | 2021 | François Roussel | |
| 2021 | Paulette Doyotte |
Le premier acte disponible portant une signature de maire est un acte de prise de possession du registre paroissial : acte du 2 décembre 1792 (AD24 – E DEP 1009)
Nous maire de la communauté de Neuvic nous sommes transportés avec notre secrétaire et réquérant le procureur de la commune dans la maison du presbitaire pour faire état et inventaire de tous les registres qui peuvent y être ce que nous avons fait par verbal de cejourd’huy et en conséquence de l’arretté qui a été aussi fait par le Conseil Général de la communauté aujourd’huy sur le défaut de papier pour parfournir à l’enregistrement tant des extraits pris en blanc par le citoyen curé que pour enregistrer ceux qui seront pris par les officiers publics qui seront nommés conformément à la loi du 20 septembre dernier il a été ajouté aux registres courants quatre feuillets de papier commun à chaque registre pour servir jusqu’au premier janvier mille sept cent quatre vingt treize au moyen de ce nous avons clos et aretté les registres servis par le citoyen curé jusqu’à ce jour 2 décembre 1792 et l’an premier de la République.
Signé : Deffarges maire
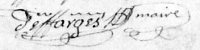
Pour la fin de l’année 1792, les actes sont signés soit de Etienne Lacour, officier public, soit de Louis Deffarges, maire.
Louis Deffarges est issu d’une très vieille famille neuvicoise étudiée par un descendant (Famille Filet).
En 1743, Pierre Deffarges épouse Marie Daugéras (21/2/1743) et s’établit marchand hostellier au bourg puis à Théorat vers 1750 (d’après les lieux de naissance des enfants). Le couple a au moins six enfants dont deux meurent en bas âge. Parmi les survivants on trouve deux Louis, l’ainé du 9/1/1744 et le cadet le 6/1/1754. D’après l’acte de décès de Jean Bruneau le 26/11/1793 , Louis Deffarges, maire, est alors âgé de 50 ans. Il s’agit donc de l’aîné. Il sera procureur fiscal avant la Révolution. Il épouse Marie Flayac, fille de Jean Flayac et Marie Bérard, dont il eut quatre enfants : Louis (1774), Jean (1777), Marie (1785) et Jeanne (1787).
Il figure dans les annuaires statistiques du département dans la liste des notaires (an 12, 1811)
Louis Deffarges est mort le 14 septembre 1818 à Théorat (74 ans, propriétaire agriculteur), et sa veuve le 21 mars 1829 au Bas Théorat à 87 ans.
L’origine d’Etienne Lacour est moins bien établie. Un Etienne Lacour naît le 21/11/1703 de Hélies Lacour et Peyronne Dauriac, au Maine. Il se marie le 24 février 1759 à Marie Deffarges (un Louis Deffarges est témoin). Le couple donne naissance à Etienne Lacour à Planèze le 12 avril 1767 (le parrain est Etienne Deffarges et la marraine Anne Lacour).
Le registre des délibérations de l’an 5 donne la composition de la « colonne mobile », un Lacour en est le capitaine, mais le prénom n’est pas indiqué.
En 1793 (an2), les actes sont signés par un officier public qui est soit Louis Deffarges, soit Delort. Un acte du 10 décembre est signé de Deffarges maire, est-ce une erreur de titre due à l’habitude?
Le dernier acte signé « Deffarges, officier public » est du 19 Frimaire an 3.
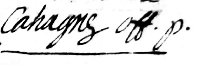
Le 21 Frimaire an 3 (11 décembre 1794) apparaît Cahagne officier public qui signe tous les actes suivants jusqu’au 10 Frimaire an 4. Sur la liste de la colonne mobile, il apparaît sous le nom de Cahagne-Latour, sergent.
Son acte de décès du 12 août 1823 apporte des renseignements importants. Charles Cahagne-Latour est âgé de 60 ans (naissance vers 1763, lieu inconnu mais ce nom ne figure pas sur les registres paroissiaux de Neuvic), il est dit instituteur, domicilié aux Cinq Ponts, fils de Annet Cahagne-Latour et Marie Rose Pignatelle, époux de Marguerite Peytoureau. Le mariage ne semble pas avoir eu lieu à Neuvic. On peut noter que le 2 Nivôse an 5, Cahagne est témoin d’un mariage et qu’il est alors cultivateur aux Cinq Ponts.
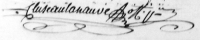
A partir du 10 Frimaire an 4 (1er décembre 1795), l’officier public est Cluseau-Lanauve, « agent municipal de la commune ». Il précise « adjoint » sur les premiers actes, cette mention disparaît le 6 Floréal an 4.

Les actes de l’an 7 sont signés de Jean Cabirol, officier public, Bernard Bleynie (de Douzillac) étant le Président de l’administration municipale du canton de Neuvic. Pierre Cluseau-Lanauve figure comme secrétaire de l’administration municipale. Le 15 Prairial an 8, Cabirol signe le dernier acte comme « agent municipal de la commune de Neuvic ».
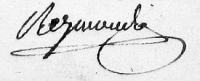
A partir du 26 Prairial an 8, le titre change, et Arnaud Reymondie signe « maire de la commune de Neuvic » (la mention « agent municipal » est rayée sur le registre pré-imprimé).
Il est notaire à Neuvic, les Archives départementales possèdent les minutes de son étude entre 1795 et 1829. Il reste maire jusqu’au début de 1813, Deffarges étant adjoint (annuaire statistique de l’an 12) et retrouve cette fonction pour quelques mois avant sa mort.
Les actes d’état civil nous donnent quelques informations : il se marie à 27 ans, le 24 janvier 1794 à Jeanne Lacour, née le 13 avril 1766, fille de Jean Lacour, sieur du Maine, maitre-chirurgien puis officier de santé à Neuvic et de Marguerite Daugéras. Ses parents sont Pierre Reymondie, notaire, décédé et Sicarie Pageot, il est né en 1767 à St Léon sur l’Isle. Son acte de décès en date du 30 septembre 1829 précise qu’il est veuf de Jeanne Lacour. Le couple ne semble pas avoir eu d’enfant né à Neuvic.

En 1813, le maire est Charles de Mellet (le secrétaire note « Demellet »), Pierre Bornet-Léger étant adjoint.
En 1814 et 1815, années de la Restauration de Louis XVIII, il est intéressant de noter les périodes pendant lesquelles le comte est absent. Du 22 avril au 18 juin, tous les actes étant signé par l’adjoint Pierre Bornet-Léger. Du 5 juillet au 21 août, les actes sont signés de Charles, comte de Mellet, chevalier de Saint Louis, puis les actes sont à nouveau signés par l’adjoint jusqu’au 19 avril 1815 où l’on retrouve « Demellet » (on est pendant les « Cent jours ») . A partir du 11 septembre, Pierre Bornet-Léger signe d’abord comme adjoint puis comme maire le 10 décembre 1815. Le comte a-t-il quitté Neuvic à la faveur de la Restauration ?
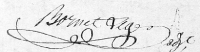
Pierre Bornet-Léger est resté maire de 1815 jusqu’à sa mort le 17 novembre 1827. A partir du 15 août 1827, les actes d’état civil sont signés « Faure Jean adjoint » et jusqu’au 6 août 1828.
L’acte de décès de Cyprien Pierre Bornet-Léger précise qu’il était médecin , fils de feu Pierre Bornet-Léger, avocat, et de Léonarde Marie Poumeyrol. Il était né le 25/11/1786 au bourg, son père était alors juge de Neuvic.
Thèse éditée à Paris en 1810 : « Propositions sur quelques points de physiologie, de chirurgie et de médecine, relatifs aux organes de la respiration »
Puis reparait la signature d’Arnaud Reymondie, maire pendant une année, jusqu’à sa mort le 30 septembre 1829. L’intérim est assuré par Bornet-Lagirondie, adjoint, avant la nomination de Chapelou St Pey qui signe son premier acte comme maire le 8 novembre 1829. Bornet-Lagirondie est adjoint en 1832, puis Devillesuzanne-Lagarde en 1835.
On peut noter que Bornet-Lagirondie était un cousin de Pierre Cyprien Bornet (leurs grands-pères étaient frères) et que Chapelou St Pey était marié à une cousine germaine de Pierre Cyprien ! Et comme le frère de Pierre Cyprien sera maire de 1852 à 1854, la famille Bornet aura eu quatre de ses membres à la tête de la municipalité.
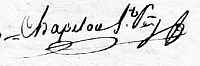
François Chapelou est né à la chartreuse des Cinq Ponts le 31/12/1778, fils de Pierre Chapelou et de Catherine Merlhe (ou Merlhie). D’après l’acte de naissance de sa sœur Jeane (le 14/1/1778) son père était le juge de Villamblard. Le 17 mai 1831, à 53 ans, il épouse Jeanne-Claire Bornet (née en 1799). Le couple aura deux filles, Eléonore née le 7 mars 1832 et Anne-Athalie née le 4 septembre 1834.
François Chapelou St Pey meurt le 10 juin 1836.
Son successeur est son ancien adjoint, François Devillesuzanne-Lagarde, notaire au bourg de 1832 à 1865 (minutes disponibles aux Archives départementales).
Il est maire pendant toute la Monarchie de Juillet . C’est sous ses différents mandats que sera construit le bâtiment abritant la halle, la mairie et la justice de paix, aménagée et élargie la rue du Majoral Fournier au départ de la place du Chapdal. (article de JJ Elias dans le bulletin municipal).
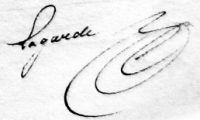
François Devillesuzanne-Lagarde est né à St Germain du Salembre, fils de Pierre et d’Hélène Masselon. Il est l’époux d’Anne Marie Dumas, originaire de Cognac (cf.acte de décès à Neuvic le 19/2/1882). Le couple a une fille, Elisabeth-Hélène, née à Neuvic le 11 novembre 1837 qui épouse le 17 juin 1863 Jean Baptiste Armand Rougié, né le 3 janvier 1837 à Bretenoux (Lot), licencié en droit, fils de notaire qui prendra la succession de son beau-père en 1865 et qui sera également maire à la fin du siècle.
« Le 7 avril 1848, après l’avènement de la deuxième République, un arrêté du préfet révoque Devillesuzanne-Lagarde et tout le conseil municipal. Un authentique républicain est nommé comme maire : le docteur Cluseau-Lanauve » (article de JJ Elias)
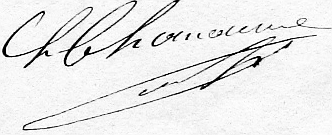
Léon Cluseau-Lanauve est né à Frateau le 24 mai 1815, fils de Pierre Cluseau-Lanauve, notaire à Neuvic de 1798 à 1832 (AD24) et de Marie-Rose Bernard. Le couple a sept enfants, Léon étant le quatrième et l’aîné des garçons après le décès à 19 ans de son frère Isaac. Sa thèse de docteur en médecine (publiée en 1839) est intitulée « Des dangers des piqures du globe de l’œil « . Le 4 août 1841, il épouse Pétronille Pajot-Laforêt (qui signe Clorinte Laforêt), née à St Léon le 19 septembre 1817. Ils ont eu deux enfants, Marie-Louise et Charles Joseph, grand-père de Jean Cluseau-Lanauve, peintre né en 1914 à Périgueux, décédé en 1997.
Ardent républicain n’hésitant pas à manifester son opposition aux dérives bonapartistes, Léon Cluseau-Lanauve est suspendu de ses fonctions le 15 décembre 1850 puis révoqué définitivement par un décret présidentiel.
Antoine Maze, adjoint, est désigné comme maire provisoire et devient maire en février 1851 et jusqu’au 31 juillet 1852 où il redevient adjoint…il le sera encore en 1870 et demeurera conseiller municipal jusqu’en 1884.
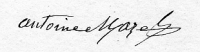
On retrouve des ancêtres d’Antoine Maze jusqu’en 1600, toujours au village des Meuniers où naît son père Pierre dit Jarrissou. Antoine est né le 13 mars 1795 aux Meuniers mais il semble que ses parents se soient installés à Planèze à partir de 1799 (naissances de ses sœurs cadettes). Le 12 février 1825, il épouse Marie Bruneau, descendante d’une vieille famille de Planèze et ils auront six enfants. Il meurt le 20 décembre 1888 à Planèze à 93 ans.
Le 1er août 1852, le préfet désigne François Bornet-Léger comme nouveau maire. Son mandat est de courte durée puisqu’il démissionne le 31 décembre 1854.
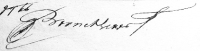
Né le 19 janvier 1796 au Chadal (sic), François est un frère cadet de Pierre Cyprien (maire de 1815 à 1827). Lieutenant d’Infanterie, il est nommé chevalier de la Légion d’Honneur le 30 septembre 1814. Il est ensuite juge de paix à Neuvic. Son épouse est Marie-Catherine Capmartin, ils ont eu trois enfants Marie-Louise, Paul Pierre Alexis et Suzanne Marie. Il décède à Neuvic à 91 ans le 28 février 1887.
« Devillesuzanne-Lagarde est nommé par le préfet et doit immédiatement prêter serment d’obéissance à la Constitution et fidélité à l’Empereur, il sera régulièrement reconduit dans ses fonctions de maire pendant tout le Second Empire, soit pendant quinze années. C’est durant cette période que fut ouverte la rue de Théorat permettant ainsi la construction de l’école des Frères en 1857 et de la gendarmerie en 1860 » (JJ Elias).
Après son premier mandat de douze ans (1836-1848), François Devillesuzanne-Lagarde aura donc été maire pendant vingt sept ans.
Avec la fin de l’Empire et les débuts difficiles de la Troisième République commence une période plus agitée où les maires de Neuvic se succèderont pour de courts mandats.
Retrouvons le récit de JJ Elias : « Le 12 septembre 1870 un arrêté du préfet désignait Charles Alban Cluseau-Lanauve comme maire de Neuvic, mais coup de théâtre, le 1er octobre, Vidal Claude Marie Georges s’est présenté devant Antoine Maze, adjoint en fonction dans la commune de Neuvic, et l’a requis de procéder à son installation comme adjoint remplissant provisoirement la fonction de maire de la commune de Neuvic. Il lui a remis à l’appui de sa demande un arrêté de Mr le Préfet de la Dordogne en date du 17 septembre dernier qui le charge des fonctions d’adjoint ».
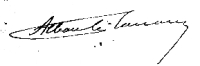
Né le 19 février 1845 au bourg, Alban Cluseau-Lanauve, maire pendant quelques jours, était le fils de Léon, médecin et maire de Neuvic entre 1848 et 1850, et de Pétronille Pajot-Laforest. Aucun acte d’état-civil ne porte sa signature pendant cette période : Devillesuzanne-Lagarde signe jusqu’au 16 sept, Antoine Maze assure l’intérim et la signature de Vidal apparaît le 2 octobre.
Alban Cluzeau-Lanauve sera à nouveau adjoint de 1878 à 1881 puis conseiller municipal jusqu’en 1884.
Une nouvelle « dynastie » familiale apparaît avec les Vidal et Mathet et on peut noter qu’ils ne sont pas issus de familles neuvicoises anciennes.
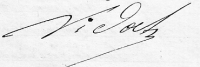
Né à Saint Orse le 16 janvier 1807, fils de Gabriel Vidal et d’Hélène Montagut, Claude Marie Georges Vidal est propriétaire à la Grande Veyssière (cf. acte de décès du 16 janvier 1878). Son épouse est Hélène Mathilde Laroche (née à Bassillac le 17/4/1819, décédée à Neuvic le 12/1/1876). Le couple a deux enfants, Gabrielle Jeanne (née en 1837 à St Orse, décédée à la Grande Veyssière le 2/9/1897, épouse de Jacques Gabriel Mathet) et Gabriel Guillaume Albert (né à St Orse en 1844, notaire à Neuvic de 1879 à 1887), décédé à Neuvic à 43 ans le 6/12/1887, époux de Marie Félicité Reymondie, maire de Neuvic de 1879 à 1882.
En 1871, la commune envisage l’achat de la maison Dumas (Villa Julienne) pour y établir l’école de filles, mais elle n’a pas pu faire l’emprunt nécessaire. C’est Mlle Labaysse, institutrice, qui achète la maison, prend en charge les réparations et en loue une partie à la commune pour y loger l’école.
Après la démission de Claude Vidal le 24 août 1873, c’est le docteur Grellety-Bosviel qui est nommé maire, Rougié restant adjoint. Au cours de son mandat Jean Pouget fit un legs important qui, après de multiples péripéties, permit la construction de l’hôpital-hospice. Les autre réalisations marquantes ont été la rénovation du nouveau presbytère (ancienne maison Roux), la réparation de l’église et la construction du clocher (financée par le Conseil de Fabrique), et surtout le pont de la gare qui sera à péage jusqu’en 1886.
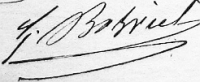
Gabriel Grellety-Bosviel est originaire de St Meyme, né en 1807, fils de Louis (instituteur, professeur de langue latine, maire de St Mayme en 1819)) et de Marie Grangille-Mirabel. Son épouse, Jeanne Reymondie est née à Eglise Neuve en 1809. Il est officier de santé à Neuvic. Le couple a au moins quatre enfants nés à Neuvic : Louis Octave (16/01/1832) qui deviendra avoué, Jeanne Octavie (11/02/1835), Pierre Joseph Léo (29/05/1837) et Gabriel-Ambroise (7/12/1846) qui sera médecin à Neuvic en 1867 et jusqu’en 1926 !
Gabriel Grellety-Bosviel a été maire de 1873 à 1878 puis de 1882 à 1888. Il meurt à Neuvic le 16/10/1889 à 82 ans.
Entre 1873 et 1878, c’est l’adjoint Rougié qui signe la quasi-totalité des actes d’état civil.
Après les élections de janvier 1878, le notaire Eymard Lapeyre est nommé maire le 24 février 1878 (décret de Mac-Mahon), Alban Cluseau-Lanauve étant adjoint. Mais le 24 juin 1879, il est contraint de démissionner avant de quitter Neuvic à la suite d’accusations de malversations.
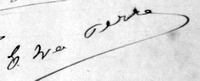
Eymard Lapeyre n’a laissé aucune trace dans l’état civil, hormis sa signature dans quelques actes.
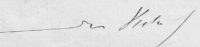
Gabriel Vidal est nommé maire en juin 1879, le sous-préfet de Ribérac estimant que Bosviel et Rougié ne sont pas politiquement sûrs ! Alban Cluseau-Lanauve reste adjoint. Son mandat n’est marqué par aucune réalisation importate. Le sous-préfet demande la construction d’une école mais les finances ne permettent pas d’aller au delà de l’achat d’un terrain au Villageou. En 1881, le Conseil déplore que le maire réside à Mussidan et qu’il n’ait pad d’adjoint.
Son mandat s’achève en avril 1882 où le conseil municipal élit Gabriel Bosviel comme maire et Rougié comme adjoint continuant d’assurer régulièrement les fonctions d’officier d’état civil.
En novembre 1882, les plans de l’école de garçons et de l’hospice sont présentés par l’architecte Mandin de Périgueux. Le plan de l’école de filles suivra en 1883 mais les constructions ne seront réalisées que plusieurs années après : 1886 pour l’hospice, 1890 pour l’école de filles et 1900 pour l’école de garçons…
En mai 1888, Rougié devient maire, avec Bordier comme adjoint.

Jean Baptiste Armand Rougié est né près de Bretenoux dans le Lot, fils de Jean Louis Frédéric, notaire à Teyssieu (Lot) et de Marie Madeleine Prat. Le 17 juin 1863, il devient neuvicois en épousant Elisabeth Hélène Devillesuzanne-Lagarde née le 13 novembre 1837, fille du notaire et maire. Il reprend l’étude de son beau-père en 1865 et restera notaire à Neuvic jusqu’en 1895. Le couple aura une fille, Marie Caroline Madeleine, née le 4 juillet 1864 à Théorat qui épousera Antoine Marie François Fayolle-Lussac, à Neuvic le 12/04/1887.
JB Rougié est mort à Neuvic le 6/04/1921, son épouse le 29/08/1926.
Jean Bordier, fils de Jean Bordier meunier au moulin du Pont et d’Isabeau Deleymet, est né le 26 octobre 1840. Il épouse Jeanne Lamy, le couple a trois filles Isabeau (1866), Jeanne (1869) et Marie (1875). D’après les actes de naissance des deux premières, il est meunier au moulin du Pont avec son frère ainé Guillaume, puis il est dit propriétaire cultivateur à Vincent. Les sœurs Jeanne et Marie épousent en 1896 et 1899 les frères Léon et Jean Elias, meuniers à la Petite Veyssière.
En 1889, un emprunt de 50 000 F permet la construction de l’école de filles sur un terrain vendu par la famille Bornet-Léger, mais l’école de garçons est toujours dans un état déplorable.
« En mai 1892, changement brutal, c’est une équipe plus républicaine qui fait son entrée à la mairie » (JJ Elias). Gabriel Mathet est élu maire et Alexis Maze est son adjoint.
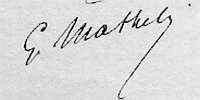
Gabriel Paul Mathet est né à Périgueux de Julien Mathet, percepteur et Marie Ursule Bonne Vidal, fille de Claude Marie George Vidal (ancien maire) et d’Hélène Laroche. En 1866, il est employé aux lignes télégraphiques à Lyon et il termine sa carrière comme directeur des Postes à Périgueux. Le 3 avril 1866, il est témoin du mariage de son frère Jacques Gabriel Mathet, docteur es-sciences, professeur de mathématiques au lycée impérial de Lyon avec sa cousine germaine Gabrielle Jeanne Vidal.
Sur le recensement de 1901, on note que les frères Jacques-Gabriel (70 ans) sans doute veuf, et Gabriel-Paul (63 ans) célibataire, sont déclarés comme rentiers et ils vivent avec une cuisinière, Louise Vieilleville.
Gabriel Mathet meurt à la Grande Veyssière le 12 octobre 1901 à 64 ans.
Alexis Maze, fils d’Antoine (ancien maire) et de Marie Bruneau est né à Planèze le 20/02/1840. Il épouse Jeanne Joséphine Fond, née à Lyon. Le couple a deux enfants, Charles né en 1880 et Marie en 1889.
Alexis Maze, « propriétaire sans profession », meurt le 01/02/1915 à Planèze.
Le rachat du péage du pont de Planèze est réalisé en 1893, une souscription a rassemblé le quart de la dépense.
Le projet d’alignement présenté en mars 1892 va définir ce qui deviendra le visage de Neuvic que nous connaissons, en particulier dans l’avenue de la gare. Le choix d’un terrain pour la construction de l’école de garçons divise le conseil municipal, une majorité se prononce pour un terrain de l’avenue de la gare, contre le maire, l’adjoint et J. Gaussen qui préfèrent un terrain route de Théorat (terrain Lapluie), ce choix a aussi la préférence de l’inspecteur d’académie.
Ce désaccord persistant, Mathet et Maze démissionnent en 1893 et le 16 juillet le conseil municipal élit Félix Justin Gaussen comme maire et Paul Texier comme adjoint, mais la division persiste, Gaussen est élu avec 8 voix contre 6 à Dubois et en novembre 1893 la majorité confirme la volonté d’acheter le terrain de la route de la gare. Le maire se maintient malgré le blocage, toutes les décisions sont contestées, de nouvelles élections sont organisées en juin 1895.
Au troisième tour de scrutin, Rougié est élu maire (égalité de voix avec Gaussen), son adjoint est Bosredon, lui aussi élu au bénéfice de l’âge. Le maire propose un troisième emplacement, terrain situé à côté de la gandarmerie (propriété Bornet-Léger), il n’est pas suivi par le Conseil qui continue à soutenir le projet de la route de la gare, le préfet impose le terrain Lapluie puis deux mois plus tard il accepte le terrain Bornet-Léger ce qui débloque la situation, le Conseil municipal protestant pour la forme contre la méthode du préfet ! Un emprunt est immédiatement voté pour réaliser la construction qui est en attente depuis 20 ans.
L’intérim mouvementé de Rougié est de courte durée puisque les élections de mai 1896 provoquent un renouvellement de la moitié des conseillers et l’élection de Félix Gaussen et de Victor Lescure (adjoint).
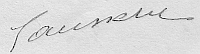
Félix Justin Gaussen est né le 16 février 1840 à Bourrou, fils de Marcel Gaussen et d’Antoinette Reynier. Il a d’abord une carrière militaire : engagé en 1859 au 91e régiment d’infanterie de ligne comme simple soldat, il rejoint l’infanterie de marine en 1860 comme caporal et gravit tous les grades de sous-officier durant les campagnes d’Extrème-Orient, avant de devenir sous-lieutenant en 1870. Il quitte l’armée en 1881 avec le grade de capitaine adjudant major. En 1882 il est fait chevalier de la Légion d’Honneur. (Source : Base leonore).
Il est élu conseiller municipal en 1892, puis maire de 1893 à 1895 et surtout de 1896 à sa mort le 30 mars 1905.
Le choix de l’emplacement de l’école de garçons étant enfin réglé, la construction démarre rapidement, même si une minorité souhaite limiter à deux classes plutôt que trois…
En 1897, Paul Texier remplace Victor Lescure comme adjoint.
Après les élections de 1900, Félix Gaussen est réélu maire à l’unanimité mais une nouvelle polémique ne tarde pas ! En 1901, le maire présente un projet de construction d’une halle, mairie, justice de paix sur le terrain Lapluie. Une minorité s’oppose en s’inquiétant du « déplacement du centre commercial de Neuvic » (déjà !). Six conseillers démissionnent…et sont réélus dans la foulée. Un nouveau projet,plus modeste, ne comprenant plus que la mairie et la justice de paix est finalement choisi et réalisé en 1905 (architecte Meunier, remplacé par Dublin après son décès). C’est la mairie telle que nous l’avons connue avant la rénovation et l’agrandissement réalisé en 2014.
Félix Gaussen est réélu en mai 1904 mais il meurt en mars 1905. Eugène Gallais est élu lors de l’élection partielle et il est aussitôt élu comme maire à l’unanimité.
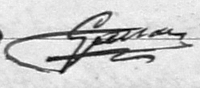
Né à Grand-Madieu (Charente) le 27 novembre 1845, François Eugène Gallais est agent-voyer à Neuvic lorsqu’il épouse Alice Manem, issue d’une très ancienne famille de Gimel. Le couple aura un fils Jules Jean François qui deviendra receveur de l’enregistrement mais mourra à trente ans à Neuvic.
Paul Texier est né à Bonnes (Charente) le 31/12/1846. En 1850, il épouse Marie Léonie Valentin, fille d’Eloi Valentin et d’Elisabeth Cabirol, marchand drapier à Neuvic.
Elu une première fois en 1892, il est adjoint de 1893 à 1895. Puis, il est à nouveau adjoint de 1900 à 1918. Il meurt à Neuvic le 9 déc 1923. Son neveu, Camille Valentin sera maire en 1931.
En 1908 et 1912, Gallais et Texier sont réélus comme maire et adjoint. Ils resteront en place pendant la durée de la Grande Guerre et auront la très lourde responsabilité d’annoncer aux familles la mort de 90 Poilus.
Après leurs démissions en janvier 1918, Louis Dubos est élu « délégué chargé des fonctions de maire ».
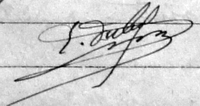
Louis Emile Dubos est issu de deux familles implantées à Neuvic depuis plus de deux siècles, avant même l’apparition des premiers registres paroissiaux !
Son père Pierre Dubos (1832-1865), cultivateur à Planèze est le fils de Pierre Dubos (1806-1889), charron à Villeverneix et de Jeanne Aubisse (1805-1847). Sa mère, Jeanne Cassier (1831-1883) est la fille de Louis Cassier et Pétronille Doche, de Planèze.
Il est instituteur à St Germain lorsqu’il épouse le 1/10/1883, Jeanne Marie Justine Lacour, institutrice à Quinsac, dont les parents habitent à St Astier (Fonvaleix).
Le couple sera nommé à Sourzac, de 1884 à 1913 et aura un fils, Pierre Jean Louis, né le 5/7/1884.
Louis Dubos est élu sans discontinuer de 1895 à 1925, il prend sa retraite à Planèze en 1913.
Il meurt à Planèze à 74 ans, le 23 janvier 1932.
Les premières élections après la guerre se déroulent le 30 novembre 1919. Louis Dubos est élu maire à l’unanimité, Edmond Lavignac, vétérinaire, est son adjoint.
Le monument aux morts est inauguré le 16 octobre 1921, les premiers branchements électriques sont réalisés, un arrêté limite à 12 km/h la vitesse des automobiles dans l’agglomération…
Les élections de 1925 provoquent un renouvellement important (10 nouveaux élus). L’élection au poste de maire voit s’affronter deux industriels de la chaussure : Fernand Laporte est élu par 8 voix contre 6 à Léopold Marbot. L’adjoint reste Edmond Lavignac.
Fernand Jean Laporte est né à Théorat le 11 avril 1880, fils de Jean Laporte, cultivateur, et de Jeanne Lescure. En 1900,d’après sa fiche matricule, il est étudiant en pharmacie, puis il est fabricant de chaussures et maintenu dans son usine pendant la guerre.
En 1929, Fernand Laporte est élu au premier tour, mais il n’est pas candidat au poste de maire. Yvan de Laporte lui succède.
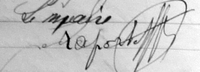
Arnaud Laporte nait à Béleymas le 24 avril 1863. Il est fils de Jean Laporte et Catherine Merlet qui s’étaient mariés à Sourzac le 7 mai 1862. Une mention marginale indique que depuis un jugement du tribunal de Bergerac en date du 13 février 1884, il faut lire « de Laporte » au lieu de « Laporte ». Lors de son mariage, il est huissier, en 1906 il est greffier, et agent d’affaires en 1926. Une notice généalogique plus détaillée lui sera consacrée.
Arnaud de Laporte est conseiller municipal de 1900 à 1908. En 1913, il devient secrétaire de mairie en remplacement d’Urbain Deffarges et le reste jusqu’en 1922, remplacé alors par Clerc. A nouveau élu en 1929 à 66 ans, il est le doyen du Conseil municipal et il est élu maire au premier tour avec 9 voix, les autres se portant sur Maze(3), Allard(3) et Marbot(1). Camille Valentin est adjoint.
Arnaud de Laporte meurt à son domicile de l’avenue de Théorat le 19 juillet 1931. Veuf, sans héritiers directs, il lègue ses biens au bureau de bienfaisance et à l’hospice : maison occupée actuellement par l’ANACE et le « Trait d’Union », terrain où est construite la Résidence pour personnes âgées qui porte son nom.
Le 27 août 1931, Camille Valentin est élu maire (12 voix, Laporte 2, Allard 1), son adjoint est Georges Gaussen.
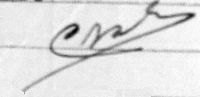
Camille Valentin, prénommé Pierre Germain à l’état civil, est né à Neuvic le 17 octobre 1875, fils ainé de Germain Valentin, marchand drapier, et d’Emilie Lambert. Il a six frères et soeurs.
Négociant à Neuvic, il épouse en 1906 à Sorges, Marie Louise Montagut, ils ont un fils Roger Louis Alphonse né en 1909.
Camille Valentin meurt à Neuvic le 13 mai 1957.
Valentin et Gaussen sont réélus en 1935 avec la plupart des conseillers sortants, mais en mars 1941, le conseil est dissout par le préfet qui nomme une équipe formée essentiellement d’anciens combattants de 14-18, mais aussi de deux prisonniers de guerre qui ne pourront pas siéger et d’une femme qui sera la première conseillère municipale à Neuvic (mais Jeanne Décoly participera rarement aux réunions).
Fernand Léon Rousset est désigné comme maire, Jean Servant étant adjoint. Le 1er mai 1943, ils démissionnent, Rousset devient l’adjoint de Fernand Laporte qui est le nouveau maire désigné.
En août 1944, au lendemain de la Libération, Camille Valentin et Georges Gaussen retrouvent leurs fonctions, entourés d’un conseil municipal provisoire formé de sept anciens conseillers et de sept nouveaux désignés par le comité de libération.
Les élections ont lieu les 29 avril et 13 mai 1945, l’armisitice est signé entre les deux tours, les prisonniers de guerre et déportés ne sont pas encore rentrés, mais pour la première fois les femmes ont le droit de vote et deux sont élues (Anne Dupond et Alice Primat). Georges Gaussen est élu maire à l’unanimité, ses adjoints sont Léo Marigeaud et Gilbert Reymondie.
De nouvelles élections ont lieu en octobre 1947, le renouvellement est presque complet mais Georges Gaussen reste maire, ses adjoints sont Paul Deffarges (vérificateur des tabacs) et Henri Naboulet (assureur à Théorat).
En avril 1953, aucun conseiller sortant n’est réélu, le docteur Jean-Robert Pascaud devient maire à la tête d’une nouvelle équipe, ses adjoints sont Jean Durieux (boucher) et Albert Chevalier (agriculteur).
